À découvrir
Découvrez aussi…
Dans la revue diocésaine Communications, l’abbé Bruno Robberechts, doyen de Leuze, propose chaque mois une sélection de quelques livres sortis récemment. Vous trouverez ci-dessous les dernières recensions publiées… Les livres présentés dans cette rubrique sont en vente dans les deux librairies CDD du diocèse à Arlon et à Namur ainsi que sur leur site web.
La vie comme nourriture. Pour un discernement eucharistique de l’humain fragmenté
Francys Silvestrini ADAO, La vie comme nourriture. Pour un discernement eucharistique de l’humain fragmenté, Editions Jésuites, préface de Christoph Theobald, Bruxelles, 2023, 563 p.
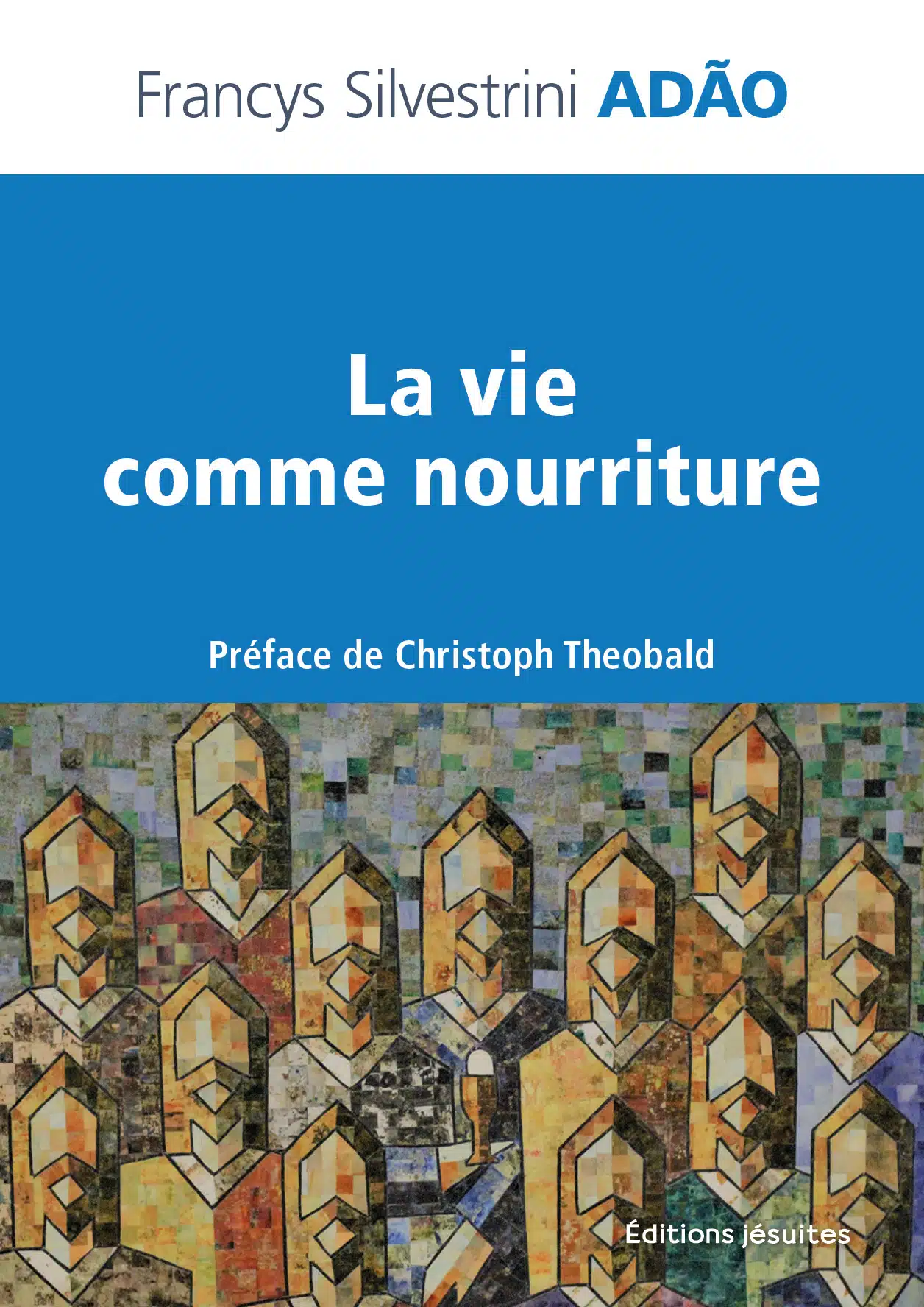
Dans une thèse de théologie originale, l’auteur a puisé à la culture brésilienne et dans le contexte de l’Église sud-américaine une leçon pour ce qu’on voit se répéter avec la post-modernité : la pluralité et la fragmentation. C’est une crise anthropologique, qui marque le passage de l’ancien au nouveau. Et il faut chercher de quoi fonder une unité plus forte, au niveau du sens. Par les différentes forces qui sont capables de faire vivre l’Église brésilienne, on peut aussi y parler d’une possible fragmentation. Par l’Eucharistie, un regard contemplatif s’ouvre à un autre sens de l’histoire, comme quand vient Jésus ressuscité dans l’épisode des disciples d’Emmaüs. L’auteur met en honneur le goût et la gastronomie et l’importance de ce qui se dit et se vit à table, il y a là une formidable parabole qui parle de ce qui construit, de ce qui rassemble alors qu’une crise affecte le sens de la vie. Le repas mystagogique est suggéré comme source de sagesse pour des repères auxquels se rallier pour dépasser la crise d’une humanité ou d’une Église fragmentées.
Le processus synodal, un chemin d’évangélisation
Isabelle MOREL (sous la direction de), Le processus synodal, un chemin d’évangélisation, Cerf (Patrimoines), Actes du XIème colloque international de l’ISPC tenu à Paris du 27 février au 1er mars 2023, Paris, 2023, 248 p.
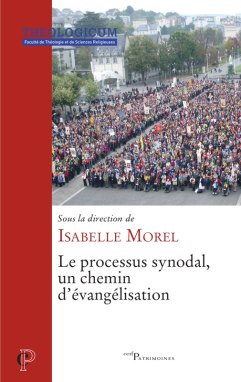
Qui a participé à la phase continentale du synode sur la synodalité a eu cette conviction que c’était là un moment historique pour l’Église. L’Institut Supérieur de Pastorale Catéchétique a saisi l’occasion pour étudier le processus synodal et son importance lors d’un colloque en mars 2023. Cette publication en reprend les contributions. Toute une réflexion théologique montre l’importance de faire des pratiques synodales déjà en cours un lieu théologique. La synodalité se nourrit d'une articulation entre pratiques pastorales et réflexion théologique sur ces pratiques. Le dialogue est important dans la synodalité, il s’agit d’apprendre à s’écouter, à dialoguer, à discerner. Une conversion personnelle et communautaire permet ainsi de mieux écouter ensemble ce que l’Esprit dit à l’Église et cela transforme la manière d’évangéliser. La pratique synodale comme processus d’évangélisation, ce fut donc la question développée par un ensemble de participants montrant une bonne diversité. Une réflexion sur une dynamique qui laisse de la place pour de nouveaux sujets actifs dans l’Église, en ne manquant pas le cercle vertueux entre synodalité et évangélisation.
Le Notre Père, présentation de François Dupuigrenet Desroussilles
Simone WEIL, Le Notre Père, présentation de François Dupuigrenet Desroussilles, Bayard, Paris, 2022, 76 p.

Simone Weil a écrit ce commentaire du Notre Père en 1942, un an avant sa mort. Au moment où se posait pour elle la question du baptême, elle avait du mal avec la notion de catholicité, car pour elle le christianisme est catholique en droit mais pas en fait pour ne pas être le réceptacle universel. Sa prière est alors celle d’une Église invisible, non confessionnelle. Elle se méfiait aussi du patriotisme dont l’Empire romain devenu chrétien aurait pu semer le germe dans l’Église. Sa pratique religieuse était la récitation en grec du Notre Père dans une attitude où elle se devait à une attention aussi grande que possible, et le désir de faire tendre à la perfection cette attention est prière. Cela suppose le renoncement à soi-même et à son imaginaire, on est alors plus disponible pour s’adresser à Dieu.
Dieu après la peur
Martin STEFFENS, Dieu après la peur, Salvator, Paris, 2023, 172 p.

Philosophe, Martin Steffens permet de distinguer dans le registre de la peur, ses différentes formes et la crainte qui y est apparentée. Chrétien, il nous permettra aussi de recevoir la crainte comme un don de Dieu, il nous fera explorer la notion de crainte pour en percevoir la nécessité dans nos relations avec Dieu, avec les autres, et même de la concevoir en Dieu, dans la relation entre le Père et le Fils. La crainte est une manière de faire de la place à l’autre et elle va avec l’humilité de reconnaître l’importance de l’autre. Dans un monde où l’on aurait tendance à faire oublier la crainte, on la perd comme issue à travers les peurs qui réapparaissent de plus belle avec les soucis. Désacraliser est une manière de bannir la crainte mais pas les peurs. Comme l’exemple des peurs de manquer des biens matériels, qui vont avec les soucis desquels Jésus veut nous libérer. Le capitalisme montre à l’inverse l’exemple d’une sorte de religion où l’argent est le « chiffre », le signe qui évalue nos soucis et par là nos entraves. Des propos qui permettent de redécouvrir que la crainte est bien un don.
Car rien n’est jamais achevé. Confessions d’un croyant discret
Robert SCHOLTUS, Car rien n’est jamais achevé. Confessions d’un croyant discret, Albin Michel, Paris, 2023, 166 p.
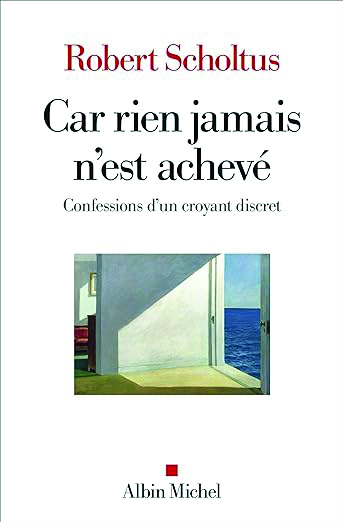
A soixante ans, Robert Scholtus s’était mis en tête de relever les inachèvements de sa vie. Dix ans plus tard, un peu de temps relâché par le confinement du Covid 19 aidant, le projet s’est remis en route. Et de ce que ce prêtre avait voulu intituler Que Dieu achève en toi ce qu’il a commencé, il s’est remis à inventorier ce que la vie a fait de lui. La vie, c’est ce qui l’a ouvert à Dieu quand il a décidé de répondre oui à Jésus, pour le service d’une Église à qui il devait ses idéaux et sa formation. La vie, c’est aussi beaucoup de rencontres, un commencement qui vient de plus loin, de l’enfance et rendant grâce pour la ferveur de ses quinze ans qui ne l’a jamais quitté, qui l’a soutenu dans un parcours de croyant contrariant et contrarié, en recevant de la douceur des années passées et l’expérience des missions endossées. Sa plume s’est bien exercée à travers des chroniques et des livres où l’écriture lui a été une manière de vivre et de croire. Oui, je crois comme j’écris, j’écris comme je crois, dit-il. Ces confessions d’un croyant discret nous font bien entendre ce qu’il a reçu des autres.
Que Croire encore ? Réponse d’une bibliste
Bénédicte LEMMELIJN, Que Croire encore ? Réponse d’une bibliste, Editions Jésuites, Bruxelles, 2023, 109 p.
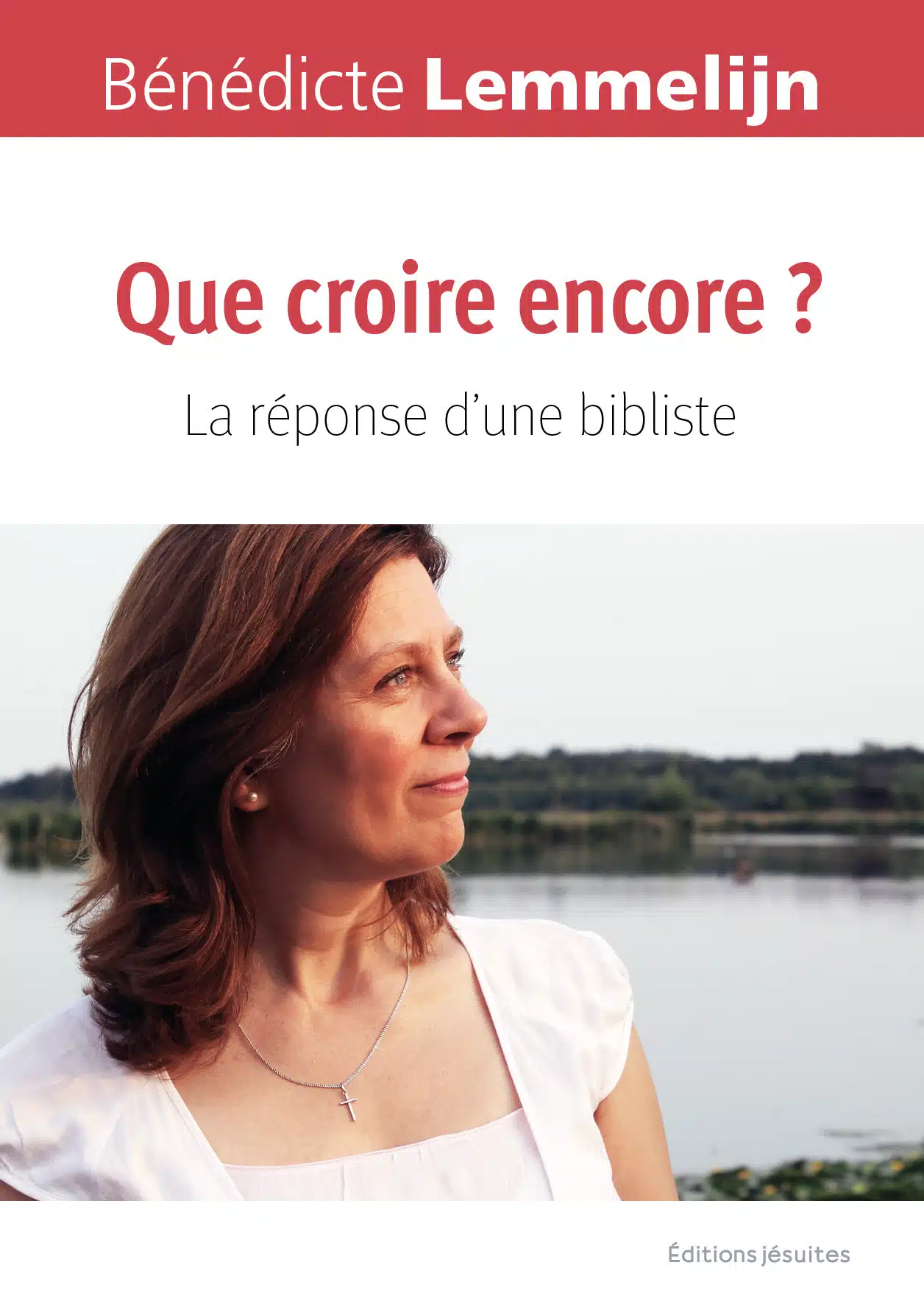
Le travail rigoureux sur le texte biblique contribue-t-il à la vie spirituelle, les découvertes qui font évoluer le travail d’interprétation ne bousculent-elles pas trop la vie d’un croyant ? Ces questions posées à l’exégète qu’est Bénédicte Lemmelijn surprendront certains. Ils pourraient même être stimulés eux aussi à étudier davantage l’Écriture qui est un remède à ceux qui auront trop vite enfermé Dieu dans l’une ou l’autre représentation. Dieu est plus grand. Découvrir comment on en est venu à dire ce qu’on dit de lui, chercher ce qu’il en est des expériences qui lui rendent témoignage, peut faire se rejoindre l’intelligence du texte et la confiance en ce Dieu dont il parle. Si bien que si la somme des connaissances s’est réduite par les certitudes qui se trouvent souvent secouée par un travail critique, l’intérêt pour ce qui apparaît essentiel et l’intuition pour ce qui permet un discernement en profondeur ont progressé. La lecture de la Bible affermit vraiment la foi et inscrit la vie dans une dynamique d’amour.
Introduction à la psychologie de la religion
Pierre-Yves BRANDT, Introduction à la psychologie de la religion, Labor et Fides, (Psychologie et spiritualité), Genève, 2023, 471 p.
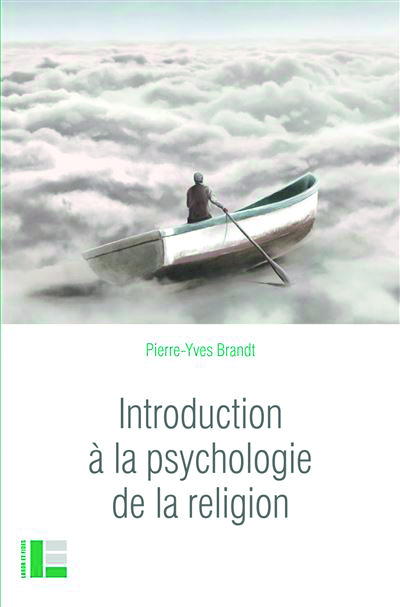
Alors que la psychologie religieuse, en rapport avec une religion de référence, donne une interprétation de la vie psychique, la psychologie de la religion, ce dont il s’agit ici, fait appel aux courants de la psychologie scientifique et à ses outils pour étudier le comportement religieux, observant ainsi différentes formes de religiosité et d’expériences spirituelles. L’option ici est de prendre d’abord une démarche développementale, repérant ce qu’il en est du comportement religieux aux différentes étapes de la vie, puis d’étudier la construction de l‘identité individuelle, alors que celle-ci s’appuie sur des éléments des traditions religieuses. Le livre aborde également les ressources que l’individu, plongé dans les épreuves de la vie, peut puiser dans la religion. Il élargit enfin ses perspectives à d’autres cultures, ce qui peut remettre en question les catégories de la psychologie occidentale. Alors qu’il se veut une introduction, l’ouvrage éveille l’attention et l’intérêt sur ces approches de la religion. Stimulant, il peut ouvrir à des lectures complémentaires qui figurent dans la bibliographie que l’on trouve à la fin de chaque chapitre.
L’inépuisable trésor intérieur
Ingmar GRANSTEDT, L’inépuisable trésor intérieur. Etty Hillesum. Mémoire et résurrection, Édition Peuple Libre, Lyon, 2022, 230 p.

L’intuition de ce livre est venue sur les lèvres de l’auteur quand il a promis à Anne, son épouse, d’avoir d’elle une mémoire résurrectionnelle. Atteinte d’une dégénérescence, en particulier de la mémoire, le bilan médical d’Anne annonçait que son décès était proche. Ingmar s’est récemment replongé dans la lecture d’Etty Hillesum. Anne et Ingmar étaient proches du Père Pïerre Ganne, jésuite, qui les aida en son temps à avancer dans la foi et qui permit à Ingmar de s’ouvrir au message d’Hillesum. Est aussi revenu à Ingmar le parcours de Georges Haldas, auteur suivant l’évangile et en particulier, le témoignage de Marie-Madeleine : Haldas parle d’une mémoire profonde, créatrice. Le témoignage d’Etty Hillesum fait découvrir comment une vie peut être expérience d’une unité profonde, où le présent n’est plus isolé du passé, où la mémoire est inscrite sur fond d’éternité. C’est sur ces bases que l’ouvrage de Granstedt esquisse l’approche de la résurrection, évoquant la force d’une présence comme celle du Christ ressuscité qui peut encore se faire intimement présent et l’être pour tous.
Dire Saint Marc, D’un texte à l’autre. Pour penser, pour prier, pour désirer
André FOSSION, Jean-Paul LAURENT, Thérèse GABRIEL (pour les peintures), Dire Saint Marc, D’un texte à l’autre. Pour penser, pour prier, pour désirer, Éditions Jésuites, Lumen Vitae, Bruxelles, 2023, 102 p.

Lire un passage de l’évangile est un chemin qui commence, le texte inspiré est inspirant. L’ouvrage reprend 20 extraits de l’évangile de Marc et laisse entendre un prolongement qui donne du sens pour le lecteur d’aujourd’hui, à travers un texte aux allures personnelles et poétiques qui invitera à s’approprier soi-même le texte pour qu’il puisse faire vivre ce que Jésus enseigne, et qu’il suscite une intelligence personnelle de l’Évangile. Les illustrations aideront un mouvement de l’esprit et du cœur ; elles feront se déplacer pour que la prière et la méditation fassent de cette lecture une rencontre avec le Seigneur.
Espérer en funambules au-dessus de l’abîme
Jean-Marc BOT, Espérer en funambules au-dessus de l’abîme, Salvator, (La foi au cœur), Salvator, Paris, 2023, 147 p.
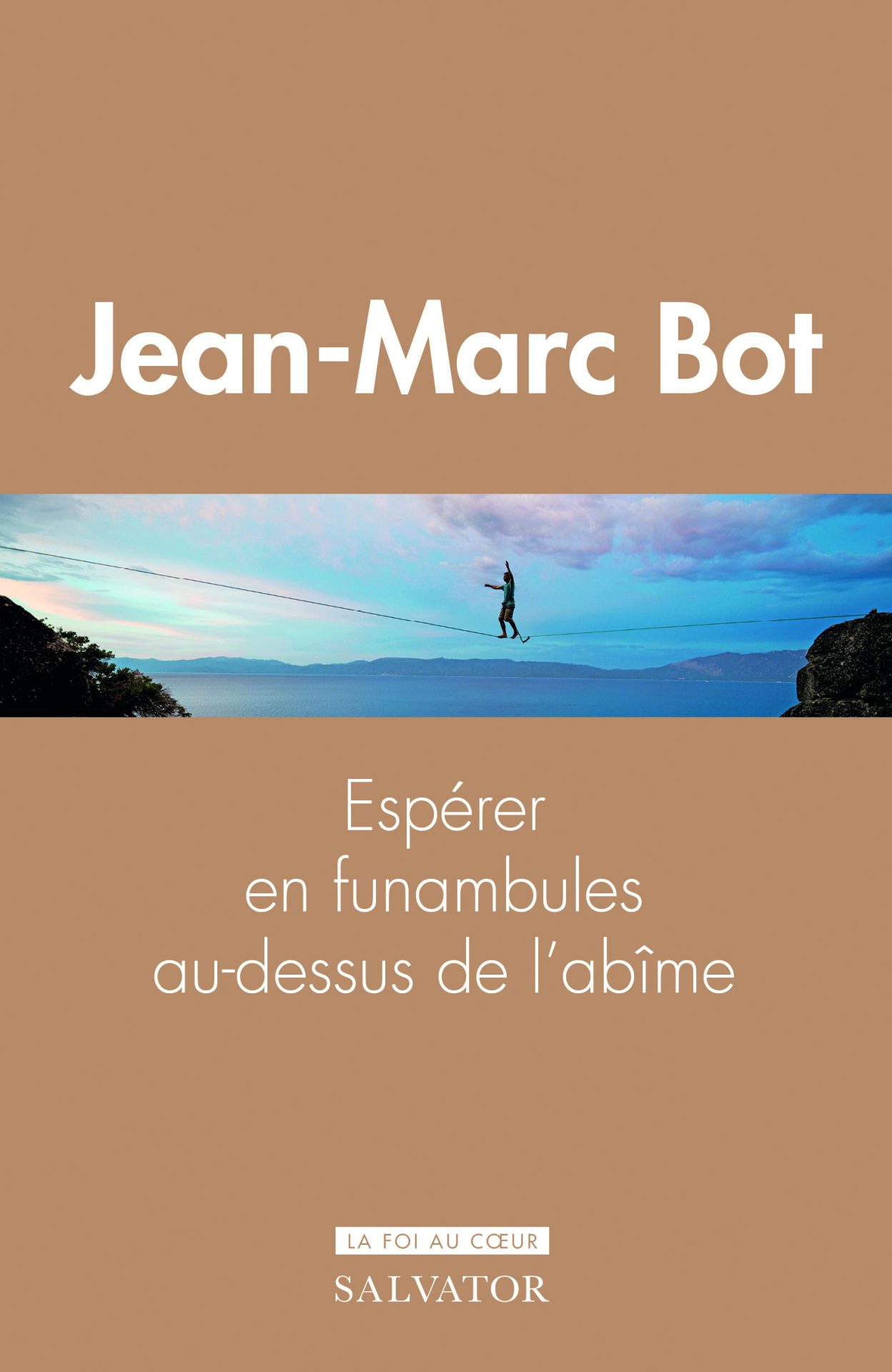
Le présent ouvrage fait des ponts entre l’Écriture où l’espérance s’enracine et l’attitude du chrétien qui témoigne de son espérance. On verra définie cette vertu théologale. On verra, mieux encore, les étapes qu’elle fait vivre à qui laisse la grâce qui est la source de l’espérance infuser dans sa vie. On verra qu’elle tisse la trame qui achemine le temps vers l’éternité. Mais sans fuir le présent, parce que son réalisme renforce l’attention au présent et l’ouvre au déjà-là de la présence du Christ. Le livre peut faire figure d’une exhortation importante par les pistes qu’il donne pour progresser sur le chemin de la prière, pour mener le bon combat dans une existence où la soif de justice peut faire avancer dans des situations jamais idéales. C’est même dans des horreurs et des catastrophes que le croyant devra, malgré tout, progresser par la force de l’espérance. Un éloge à cette vertu, à laquelle on reconnaîtra, avec Péguy, qu’elle fait retrouver de manière surnaturelle la fraîcheur perdue de l’enfance.

