À découvrir
Découvrez aussi…
Dans la revue diocésaine Communications, l’abbé Bruno Robberechts, doyen de Leuze, propose chaque mois une sélection de quelques livres sortis récemment. Vous trouverez ci-dessous les dernières recensions publiées… Les livres présentés dans cette rubrique sont en vente dans les deux librairies CDD du diocèse à Arlon et à Namur ainsi que sur leur site web.
Le sens de la terre. Penser l’écologie avec Nietzsche
Benoît BERTHELIER, Le sens de la terre. Penser l’écologie avec Nietzsche, Seuil, (L’ordre philosophique), Paris, 2023, 296 p.
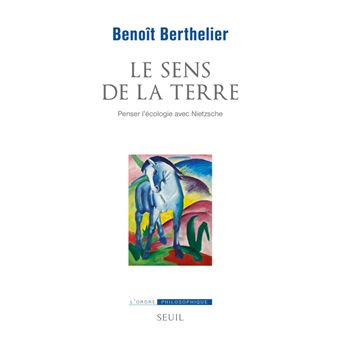
Nietzsche, lui qui renverse les valeurs établies, peut-il venir soutenir l'homme face à un monde qui semble s’effondrer ? Quand l’écologie menace de nous rendre fous ou malades, Nietzsche met en exergue, pour celui qu’il appelle le « surhomme », un sens de la terre que cet essai permet d’appréhender. Si on s’interroge sur le sens de protéger la nature, il vaut la peine de s’interroger sur le sens culturellement construit de cette dimension « naturelle » alors qu’il faudrait faire abonder les regards et les interprétations, comme autant de manières de répondre à la vie à travers les conflits qui s’y montrent. Berthelier nous fait comprendre que l’évocation par Nietzsche d’un « surhumain », s’adresse autant à ceux qui sont écrasés par la situation de la planète qu’aux autres qui semblent ne pas relever le problème, pour sortir les uns du ressentiment et détromper les autres sur les chemins de la volonté de puissance. Sans doute que moins d’anthropocentrisme s’accorde au sens de la terre, en tout cas celui-ci va de pair avec plus d’attention à la biodiversité et à la diversité des manières de vivre avec lesquelles nous aurons à inventer l’avenir.
Se convertir à Dieu avec Blaise Pascal
Hélène MICHON, Se convertir à Dieu avec Blaise Pascal, Editions du Carmel, (Vie intérieure), Toulouse, 2023, 217 p.
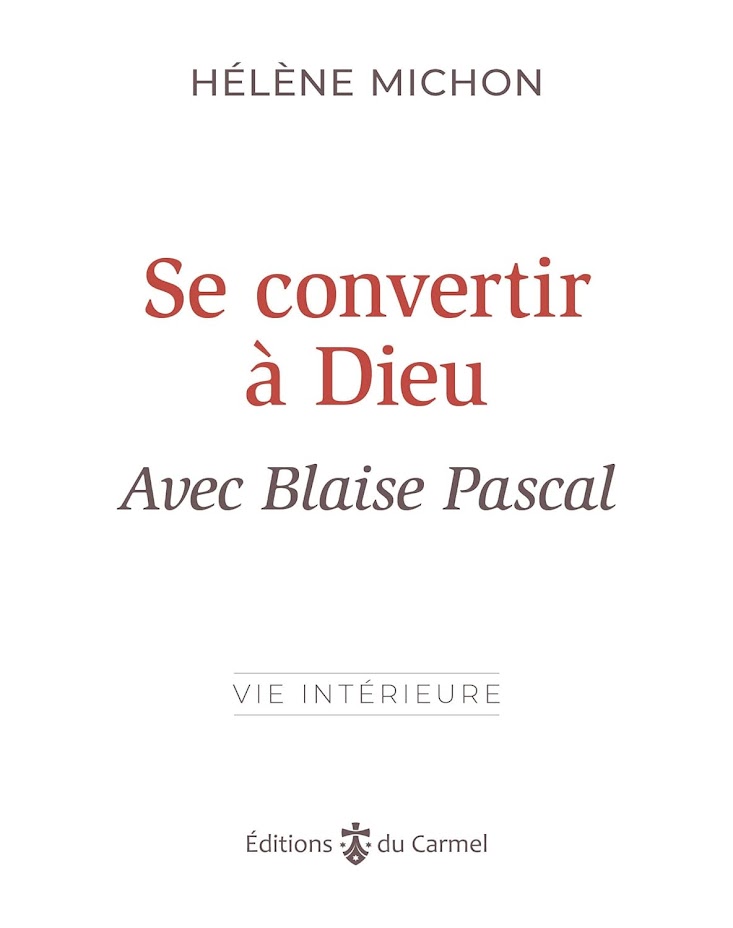
Blaise Pascal, dont cet essai donne une large présentation, est une aide pour se convertir parce qu’il démasque ce qui empêche un retour à Dieu. Hélène Michon, à qui l’on doit une thèse sur l’ordre du cœur chez Pascal, s’appuie sur une connaissance experte des textes de Pascal pour nous montrer qu’il permet de dépasser les raisons d’ordre théorique et insiste encore plus sur le cœur et sur le désir de connaître Dieu. Plus que d’arriver à penser l’existence de Dieu, c’est vivre avec lui qui importe et Pascal insiste sur la grâce par laquelle Dieu prend l’initiative. Si c’est par la révélation que Dieu peut parler de lui, il se donne dans un clair/obscur qui respecte la liberté de l’homme et met en place le désir. Il faut encore dire que Pascal, qui a écrit un abrégé de la vie de Jésus-Christ, met la médiation de celui-ci au centre et indique par-là, clairement qu’à la raison qui prétendrait accéder à la connaissance de Dieu, il faut préférer le cœur qui, mieux qu’imaginer connaître le Dieu des philosophes, peut accueillir la grâce d’aimer Dieu en répondant à un désir infini qui l’habite.
Trois jours et trois nuits
Le grand voyage des écrivains à l'abbaye de Lagrasse, préface de Nicolas Diat, post face du R. P. Emmanuel-Marie Le Fébure du Bus, Fayard /Julliard, 2021, 360 p.
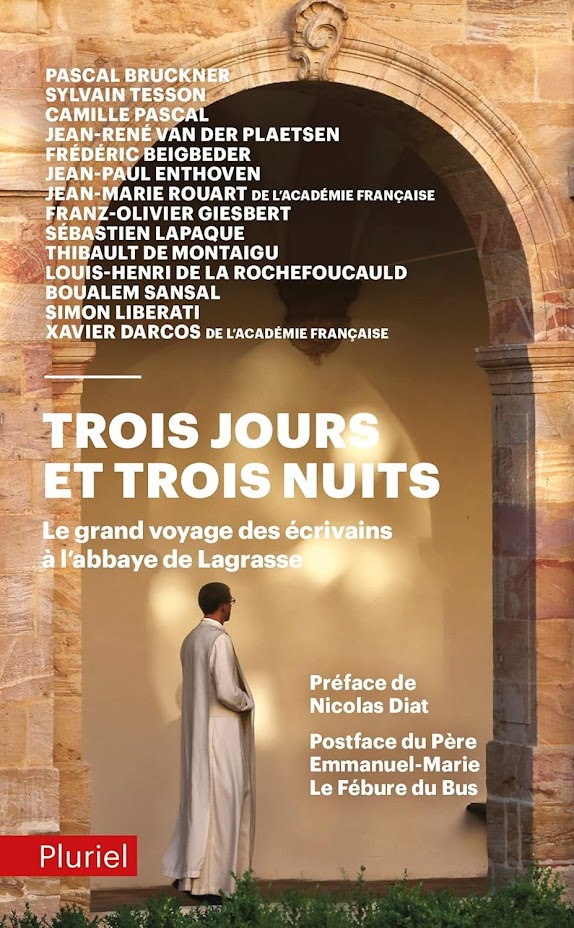
Ce livre reprend les récits d'une quinzaine d’écrivains d’aujourd’hui après trois jours et trois nuits à l’abbaye de Lagrasse, entre Carcassonne et Narbonne, une abbaye ressuscitée par une communauté de chanoines vivant la règle de saint Augustin. La diversité des personnalités, des styles, les chemins de vie plus ou moins sensibles à la dimension religieuse entremêlent confession intime, éloge de l’humanité des religieux vus comme des athlètes de Dieu ou des soldats de la prière… Ici, saint Augustin se fait encore entendre à travers le témoignage des chanoines ; là, c’est l’abbaye qui raconte les siècles et l’histoire. Le silence, le climat de prière, l’intimité de chercheurs d’absolu a inspiré de belles pages, personnelles à ces hommes. Ils ont choisi de mourir à ce qui n’est pas essentiel, nous vivons pour ce qu’ils jugent frivole, confie Pascal Bruckner. Pour des hommes à qui cette expérience était comme un défi, notamment quand la foi n’était pas partagée, des mots ont jailli pour dire l’importance de pouvoir réamorcer une ouverture à une dimension de la vie souvent sous-estimée, de chercher ce qui peut être spirituel.
Le fil sans fin
Paolo RUMIZ, Le fil sans fin. Voyage jusqu’aux racines de l’Europe, Arthaud, traduit de l’italien par Béatrice Vierne, Paris, 2022, 288 p.
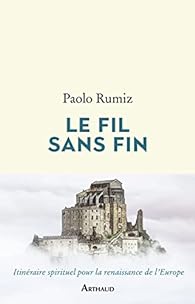
Fine plume de l’Italie, Paolo Rumiz nous emmène aux quatre coins de l’Europe, au gré de ses pérégrinations à la rencontre de bénédictins dans un parcours qui surmonte les distances et noue des relations en franchissant les murs, les barbelés, les frontières. Ces liens, les moines de Benoît les ont tissés en plantant des lieux de prière et de labeur. Ils se laissaient guider pour cela par une règle qui leur permettait de réinventer, attentifs à Dieu et aux autres, le travail et les rapports sociaux comme célébration de la grandeur de Dieu. Alors que le christianisme de demain est encore à inventer, l’auteur nous fait nous demander les fruits d’une telle rencontre de l’Europe et de ce qui a été à ses racines. Sans doute, le modèle monacal est-il une balise pour critiquer une société devenue folle sur bien des points. Après avoir suivi ce fil, Rumiz peut dire quelle belle humanité il a ainsi rencontrée. Et se demander alors : « Mon Dieu, pourquoi de telles rencontres ne suffisent-elles pas à faire l’Europe ? »
L’insolence des miracles
Didier VAN CAUWELAERT, L’insolence des miracles, PLON, Paris, 2023, 263 p.
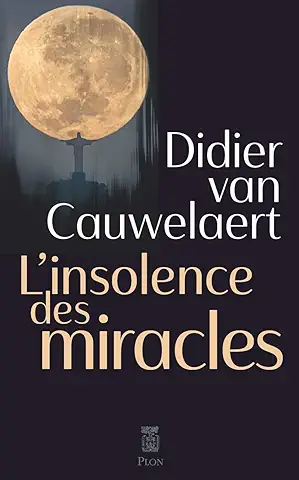
Le lecteur qui ne croit pas aux miracles trouvera dans ce livre tout autant que celui qui y croit. En effet, Didier Van Cauwelaert, sans chercher à convaincre mais à travers l’exploration de ce qui nous dépasse, tente de réconcilier l’esprit critique et l’ouverture à l’émerveillement. En passant par Lourdes, Padre Pio, Yvonne-Aimée ou Charbel Makhlouf, il rejoint des cas inclassables comme Natuzza Evolo, Emile Zola ou une musulmane miraculée lors d’un pèlerinage à La Mecque, il n’oublie pas Carlo Acutis et certaines personnes restées dans l’anonymat. Toutes témoignent à leur manière du chemin que le Seigneur s’est frayé en elles, des difficultés rencontrées mais aussi de la joie de répondre « oui » à Celui qui les interpelle dans leur vie de tous les jours. Racontant ce qu’ont vécu des miraculés, prêtant voix à des témoins, l’auteur nous permet de les rejoindre dans leur histoire. Les enquêtes scientifiques, médicales sont examinées et les relations avec le Vatican détaillées. Pourquoi depuis 1858, alors que la médecine a reconnu plus de 7200 cas de guérisons inexpliquées à Lourdes, l’Église n’en a-t-elle retenu seulement que 70 ? Comment en arrive-t-on à reconnaître un miracle et pourquoi en refuse-t-on un autre ? Pourquoi des miracles deviennent-ils de numéros de dossier en attente et pourquoi trop de miracles peut être un frein à leur reconnaissance ? Toutes ces questions trouvent des réponses dans une étude approfondie accompagnée de sérieuses références. Toutes les révélations qu’apporte cet ouvrage bousculeront peut-être le lecteur mais sans doute l’auteur veut-il montrer comment l’insolence des miracles provoque notre raison.
À l’école du doute. Apprendre à penser juste en découvrant pourquoi on pense faux
Marc ROMAINVILLE, A l’école du doute. Apprendre à penser juste en découvrant pourquoi on pense faux, PUF, Paris, 2023, 212 p.
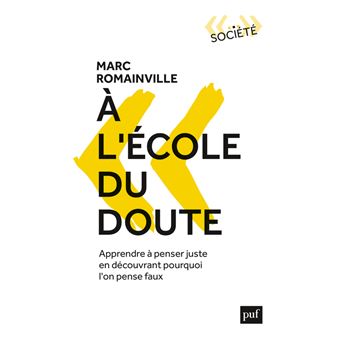
Notre époque semble avoir abandonné une notion classique de vérité. Un esprit critique doit pourtant permettre de renouer avec elle plutôt que de s’enfermer dans un credo particulier. Avec l’importance du doute, l’ouvrage fait prendre en compte le fonctionnement de notre esprit toujours prêt à se laisser enténébrer par des biais cognitifs dont le premier : il est difficile d’accepter ce qui vient désavouer ce qu’on s’était construit comme position. En ne visant encore que ce biais cognitif, dit de confirmation, on comprend bien la tactique des médias qui nous proposent à l’aide d’algorithmes, des pages en consonance avec ce qu’on aime entendre. L’éducation au doute, une pédagogie de la métacognition, rend sensible à ce qui vient embrouiller nos facultés cognitives. Il ne s’agit pas de se voir imposer une autre vérité. Le niveau « méta » risquerait de ne pas mener à un esprit critique si la démarche n’était pas ancrée dans un domaine de réalité. C’est à propos de quelque chose qu’il convient d’apprendre à quelqu’un à penser. Une réflexion sur la teneur des informations actuellement ô combien surabondantes s’impose alors que notre cerveau est plus sensible à ce dont il faut se méfier. Dans un monde qui a perdu pas mal de repères, l’esprit critique doit permettre de résister face à des explications faciles et réconfortantes et il suppose un devoir d’examiner, il implique un effort sans lequel perd sa consistance une liberté de penser.
Les racines juives de Marie, Dévoiler les mystères de la mère du Messie
Brant PITRE, Les racines juives de Marie, Dévoiler les mystères de la mère du Messie, traduit de l’américain par Xavier Géron, Artège, Paris, 2023, 233 p.
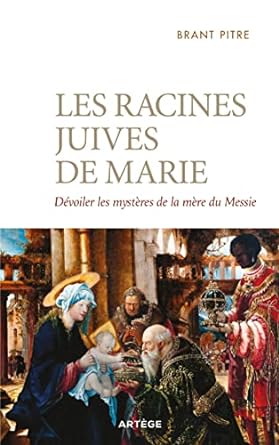
Si la Bible est assez discrète sur Marie, la tradition biblique permet de donner de la consistance à la place de la mère de Jésus. L’auteur a voulu répondre de la dévotion portée à Marie. Depuis la Genèse à l’Apocalypse, en se référant également à des écrits chrétiens de l’antiquité, il va chercher de quoi tenir que les propos sur Marie sont riches et cohérents. Pitre associe ainsi la figure de Marie à des images comme celle de la femme de l’Apocalypse, à des figures comme Eve ou Rachel, ou à encore à ce que signifie l’arche de l’alliance. Mais qu’on dise de Marie qu’elle soit reine, Mère de Dieu, ou refuge n’enlève pas qu’elle est une personne qui a pu souffrir et donc être sensible à ce que vivent les personnes qui la prient. Comme l’auteur qui dût répondre aux interpellations d’un pasteur qui le soupçonnait d’idolâtrie, découvrons que ce qui concerne notre foi sur Marie est intimement lié à ce que nous croyons de Jésus et que les propos que nous tenons de Marie s’enracinent solidement dans l’Ancien Testament. Benoît XVI lui-même ne disait-il pas que l’image de Marie est entièrement tissée à partir des fils de l’Ancien Testament ?
Un concile qui ne porte pas son nom. Le synode sur la synodalité. Voie de pacification et de créativité
Christoph THEOBALD, Un concile qui ne porte pas son nom. Le synode sur la synodalité. Voie de pacification et de créativité. Salvator, Paris, 2023, 188 p.

Christoph Theobald a travaillé très souvent sur Vatican II et sa réception, et il observe ici la mouvance que le pape François a suscitée en proposant à l’Église de vivre un synode sur la synodalité. L’observation se fait en référence aux textes de Vatican II et aux principaux documents émanant du processus synodal actuel. Synode, synodalité : les termes doivent être mis au clair car ils n’ont pas attendu François. L’attitude à laquelle renvoie le terme - marcher ensemble – est d’ailleurs bien présent dans la Bible. Ceci dit bien que les démarches synodales peuvent être regardées comme une manière de faire du chemin en parcourant les situations en même temps que les Écritures, avec une attention nouvelle, sans doute plus large, aux attitudes qui s’en nourrissent et les répercutent dans le quotidien. C’est aussi une manière d’entrer dans un vrai dialogue, de se faire attentif à la voix de tous les fidèles, s’ouvrant à autre chose, s’il le faut encore, pour que se rejoignent la réponse à l’évangile et une position d’autorité. Le changement vient aussi de ce que cette posture synodale n’est pas seulement un événement mais qu’elle est bien une part constitutive de l’Église, de sorte que le synode n’est pas un événement particulier parce que l’Église se doit d’être synodale au quotidien. L’auteur invite à tirer des conséquences de ce renversement qui demande une conversion personnelle et institutionnelle, où l’Église pourrait trouver la clé pour une nouvelle page de son histoire.
L’invention de la famille occidentale
Thomas HERVOUËT, L’invention de la famille occidentale, Salvator, Paris, 2023, 297 p.

Les temps changent et devant la famille occidentale traditionnelle, certains sont incrédules ou dédaigneux : comment imaginer des hommes et des femmes se liant exclusivement l’un à l’autre pour la vie entière ? Pour aborder cet immense ensemble que constitue, à travers les siècles, la « famille », Hervouët choisit la littérature. Car elle semble propice pour franchir cet obstacle que le plus intime peut rester obscur par manque du recul nécessaire. Le parcours passe par Homère, par la Bible avec Abraham et Joseph, par le Cid de Corneille et par Marivaux, entre autres. D’une appartenance qu’on lui aurait reconnue dans l’ordre de la nature, la famille a pu sembler relever de la transmission d’un pouvoir patriarcal dont il est temps de sortir. Joseph, homme de foi et père bien peu ordinaire, sera pris à témoin d’une sainte Famille où la question du futur d’une famille humaine laisse toute place à un autre enjeu, le salut du genre humain. Faisant allusion à Hitchcock et au cinéma, il est fait référence à des mises en lumière artificielle, alors qu’il est une autre lumière plus authentique où homme et femme peuvent se tenir intégralement en présence l’un de l’autre. Ce livre rend sensible aux lieux où cette lumière peut poindre et la famille en est un quand se renouvelle le don réciproque dans l’amour.
Paul de Tarse, l’enfant terrible du Christianisme
Daniel MARGUERAT, Paul de Tarse, L’enfant terrible du Christianisme

Daniel Marguerat, exégète qu’on ne présente pas, entend ici exhumer la vie de Paul alors qu’on pourrait rester sur l’impression des portraits impressionnants qu’on a dressés de lui. Retrouver Paul en deçà de ce qu’on a fait de lui demande de traverser deux millénaires de lecture de ses textes, et même au travers des récupérations qu’on a faites de ses arguments pour des combats qui n’étaient pas du tout les siens. La théologie de Paul, loin d’être une doctrine monolithique, est née du brasier qu’a été sa vie. Ses écrits, ses lettres, l’ont rendu présent à distance, dans une culture marquée par l’oralité, alors que les premiers chrétiens attendaient la fin du monde. Sa pensée formulée dans des lettres reprend une visée doctrinale, elle a une portée morale qui s’ajoute à l’amitié qu’entretient la lettre. Mais la lettre n’est pas tout ce qui a forgé une image de Paul. Une narration amplifiée de ses hauts faits ont fait circuler une sorte de légende paulinienne. Paul a pris conscience de son rôle comme apôtres des nations, au-delà des questions particulières sur lesquelles il intervient par ses lettres. Ce qui a fait déborder son message des occasions qui l’avaient suscité. Cela dit encore l’importance de l’impact de Paul à travers différents héritages qu’on peut lui reconnaître. C’est à travers tout cela que ce livre nous invite à rencontrer un Paul sous bien des traits souvent méconnus.

