À découvrir
Découvrez aussi…
Dans la revue diocésaine Communications, l’abbé Bruno Robberechts, doyen de Leuze, propose chaque mois une sélection de quelques livres sortis récemment. Vous trouverez ci-dessous les dernières recensions publiées… Les livres présentés dans cette rubrique sont en vente dans les deux librairies CDD du diocèse à Arlon et à Namur ainsi que sur leur site web.
En retraite avec le pape François. Appartenir d’abord à Dieu
Austen IVEREIGH, En retraite avec le pape François. Appartenir d’abord à Dieu, préface du pape François, Editions Jésuites, Bruxelles, 2024, 250 p.
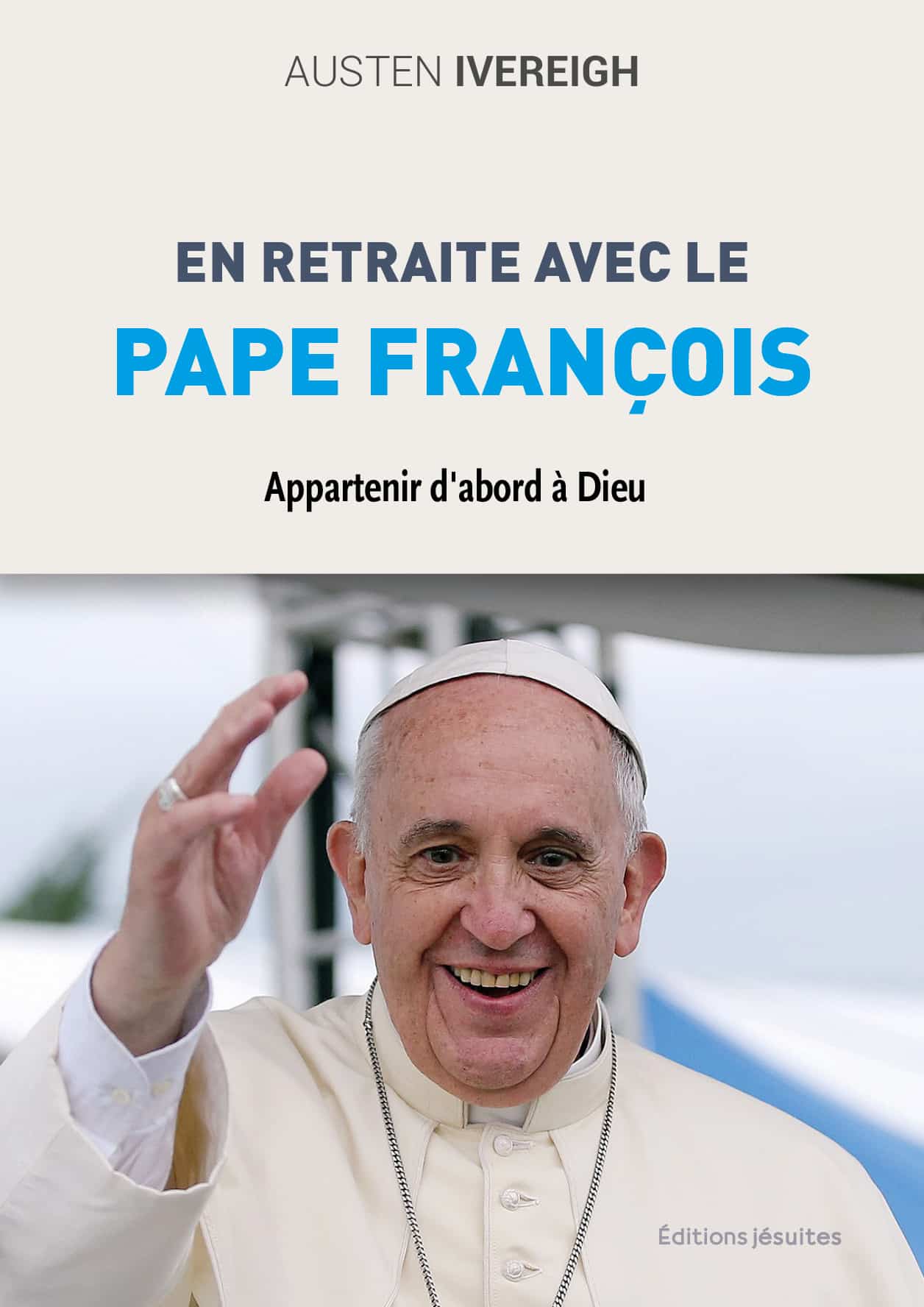
L'auteur, journaliste laïc anglais, est le fondateur du mouvement *Catholic Voices*, qui forme les chrétiens à une prise de parole pertinente. Ce livre, conçu comme une retraite ignatienne de 8 jours, s’inspire de nombreuses conférences de Mgr Bergoglio et des exercices spirituels d’Ignace de Loyola. On y trouve des méditations guidées, des références bibliques et des suggestions de lecture et de prière. L’enseignement de l’Église y éclaire la place à donner à Dieu dans nos vies. Dieu nous sauve de notre auto-suffisance, quand nous choisissons de lui appartenir. François rappelle que les crises du monde naissent souvent du refus de cette appartenance. L’esprit du mal nous tente par la recherche d’autosuffisance et l’oubli du lien aux autres. Redécouvrir cette appartenance devient une voie salutaire pour chercher la volonté du Père et écouter nos frères.
«Spiritualité». Dire la transcendance en commun
Elio JAILLET, « Spiritualité ». Dire la transcendance en commun, Labor et Fides, (Lieux théologiques, 57), Genève, 2024, 183 p.
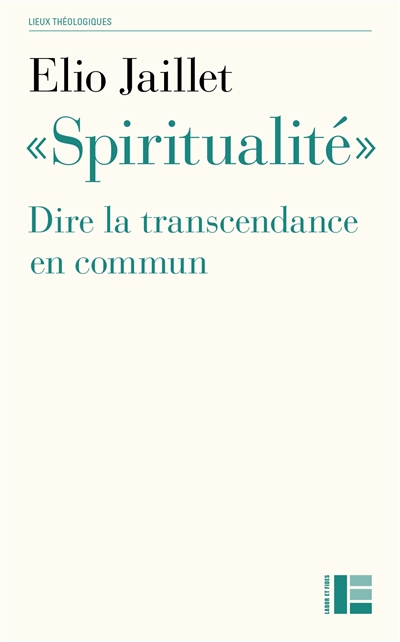
Ce livre explore les multiples facettes du mot spiritualité, s’appuyant sur les traditions mystiques et les écoles spirituelles. Sans viser une définition scientifique, il offre des repères issus des traditions catholiques et protestantes avant d’élargir la perspective. L’auteur montre combien l’échange sur le spirituel enrichit la vie commune, dépassant une opposition simpliste entre spirituel et religieux. La spiritualité devient alors un espace de partage où la condition humaine s’approprie et se nourrit d’expériences personnelles de transcendance, éclairant les tournants de la vie et révélant la richesse parfois cachée de toute existence humaine. Parler de spiritualité, c’est ouvrir un champ de communication sur ce qui donne sens à la vie. Cette quête, loin d’être abstraite, s’enracine dans l’expérience concrète et personnelle de chacun.
Mohican
Eric FOTTORINO, Mohican, Gallimard, Folio, Paris, 2021, 307 p.

Le cadre de l’histoire est une ferme dans un Jura rude et majestueux. On fait la connaissance d’un paysan malade, Brun, qui s’est laissé convaincre par les progrès de l’agriculture, par son devoir de nourrir avec les méthodes modernes, avec la chimie. Et puis il y a son fils, Mo, qui rêverait bien de montrer la beauté de ce que la terre produit par ellemême, d’en offrir la possibilité à une génération qui ne partage pas comme lui et son père, la proximité à la terre. La maladie inquiète et déstabilise Brun qui se laisse séduire, le temps d’une inconsciente absence de son ancrage rural, par un projet d’éolienne. Le chantier devient un véritable combat contre le territoire, le reste de diversité qu’il présentait. Les monstres qui défigurent le territoire éveillent ce que les spectateurs qui en sont solidaires peuvent en dire d’horreur. Le roman montre l’affrontement de deux mondes, c’est une ode à la campagne et au lien qui y unit l’homme, qui se tait quand se montre le gigantisme d’un projet d’énergie pourtant dite verte avec, dans une issue inattendue, une invitation à constater que la poésie peut donner de l’art aux gestes du cultivateur.
Dieu ne reprend pas ses dons. Itinéraire d’un chrétien pour le monde
Gérard TESTARD, Dieu ne reprend pas ses dons. Itinéraire d’un chrétien pour le monde, Nouvelle Cité, préface de Guy Aurenche, Paris, 2024, 265 p.
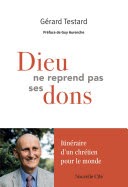
Gérard Testard partage le témoignage de sa vie de croyant, laissant transparaître la Présence de Dieu qu’il a accueillie et qui ne l’a jamais quitté. Cette relecture de vie invite à un exercice de discernement spirituel. Comment nourrir la vitalité des communautés chrétiennes sans perdre le réalisme, souvent masqué par l’accent sur l’eschatologie ? De son engagement dans la Fondation du Monde Nouveau, aux crises révélant les failles de certains responsables, il démontre l’humilité nécessaire pour rebondir et reconnaître l’initiative de Dieu même quand tout semble perdu. À travers son rôle dans Fondacio, il aborde des thèmes essentiels pour renouveler l’Église : la docilité à l’Esprit, la place des laïcs, le respect des charismes de chacun, et une bonne gouvernance. Fondateur d’Efesia, il promeut aussi le dialogue entre chrétiens et musulmans autour de Marie et de l’engagement humanitaire
Vers un paradis urbain, Approche littéraire de la ville dans la Bible
Claude LICHTERT, Vers un paradis urbain, Approche littéraire de la ville dans la Bible, Editions jésuites, (Le livre et le rouleau), Bruxelles, 2024, 279 p.
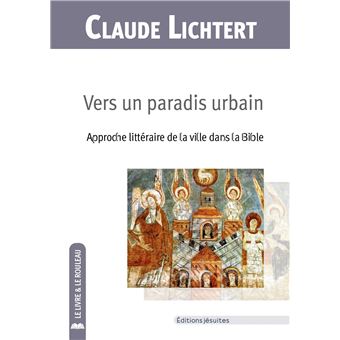
L’auteur propose une exégèse pour réfléchir au vivre-ensemble et à l'organisation de la vie collective dans l’espace urbain, sans se focaliser sur la ville comme lieu ou son histoire, mais plutôt sur le vécu de ses habitants et sa signification. L’urbanisme vise à harmoniser l’espace urbain, et, dans l’Ancien Testament, la ville recrée un cadre harmonieux rappelant le jardin d’Eden. La Bible, avec sa portée anthropologique, utilise aussi l’expérience du désert pour montrer en contraste ce qui définit la ville. Jérusalem incarne la ville sainte, tandis que Babylone symbolise le mal. La ville devient un monument vivant, un réseau d’échanges et un lieu où Dieu peut faire sa demeure parmi les hommes.
Idées reçues sur la transition écologique
Anahita GRISONI, Idées reçues sur la transition écologique, Les dessous d’une écologie néolibérale, Editions Le Cavalier Bleu, (Idées Reçues), Paris, 2024, 178 p

Parler de mesures écologiques en politique prête vite à confusion, alors qu’on assiste encore à une course en avant de ce qui est technologiquement possible. Beaucoup de fausses bonnes solutions relèvent d’une conception de la transition écologique inscrite dans une idéologie technocratique. L’encadrement politique d’une action pour réagir à la crise climatique ressemble souvent à une politique du chiffre, où des exhortations gouvernementales n’empêchent pas l'explosion de la pollution et des extractions. Si la crise climatique est nommée anthropocène, marquant l'impact humain sur l'évolution planétaire, il serait plus juste de différencier les groupes sociaux. La maîtrise de l’empreinte écologique, surtout la décarbonation, masque souvent le manque de justice écologique, qui exige d’agir sur les mécanismes de production et leur cadre sociétal. Cela permettrait de réajuster l’accent mis sur la consommation responsable, souvent inadapté pour une partie de l’humanité. La transition écologique est instrumentalisée, soutenue par de nombreuses idées reçues soulevées ici.
Le retour du tragique?
Joanna WOWICKI, Chantal DELSOL, Jean-Jacques WUNENBERGER, Le retour du tragique ? Cerf, (Patrimoines), Paris, 2024, 212 p.
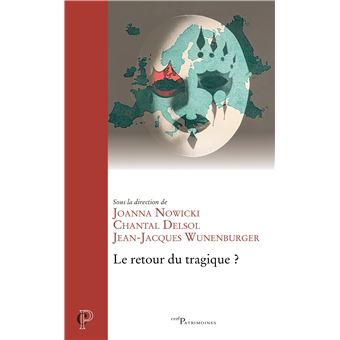
Différents auteurs ont rassemblé leurs analyses pour saisir la pertinence de ce thème du tragique mais surtout le déplacement qu’il invite à faire pour ajuster des récits sur ce que traverse l’Occident, notamment avec la possibilité de la guerre que les conflits en Ukraine signifient. Paradoxalement, alors que la maîtrise technique a pu sembler quitter le domaine des seules conditions matérielles pour prétendre toucher aussi l’organisation de la vie et ses options morales et idéologiques, ce qui apparaissait comme un progrès émancipateur laisse place à une déstabilisation. La résonance tragique, qu’on retrouve dès l’antiquité grecque, s’invite à la pensée mais demande des nuances. De quoi dire non pas tant la force du destin mais la liberté confrontée à elle. Le témoignage des penseurs politiques de l’Est ressaisit à cette aune l’expérience des régimes totalitaires. Pour l’Occident, il y a sans doute à rendre compte de l’intranquillité qui est constitutive à l’humain, qui pourrait, plus que les plonger dans l’absurde, les ouvrir à l’espérance.
L’épreuve de Dieu, peut-on encore prouver que Dieu existe?
Emmanuel TOURPE, L’épreuve de Dieu, Peut-on encore prouver que Dieu existe ? Editions Emmanuel, Paris, 2024, 165 p
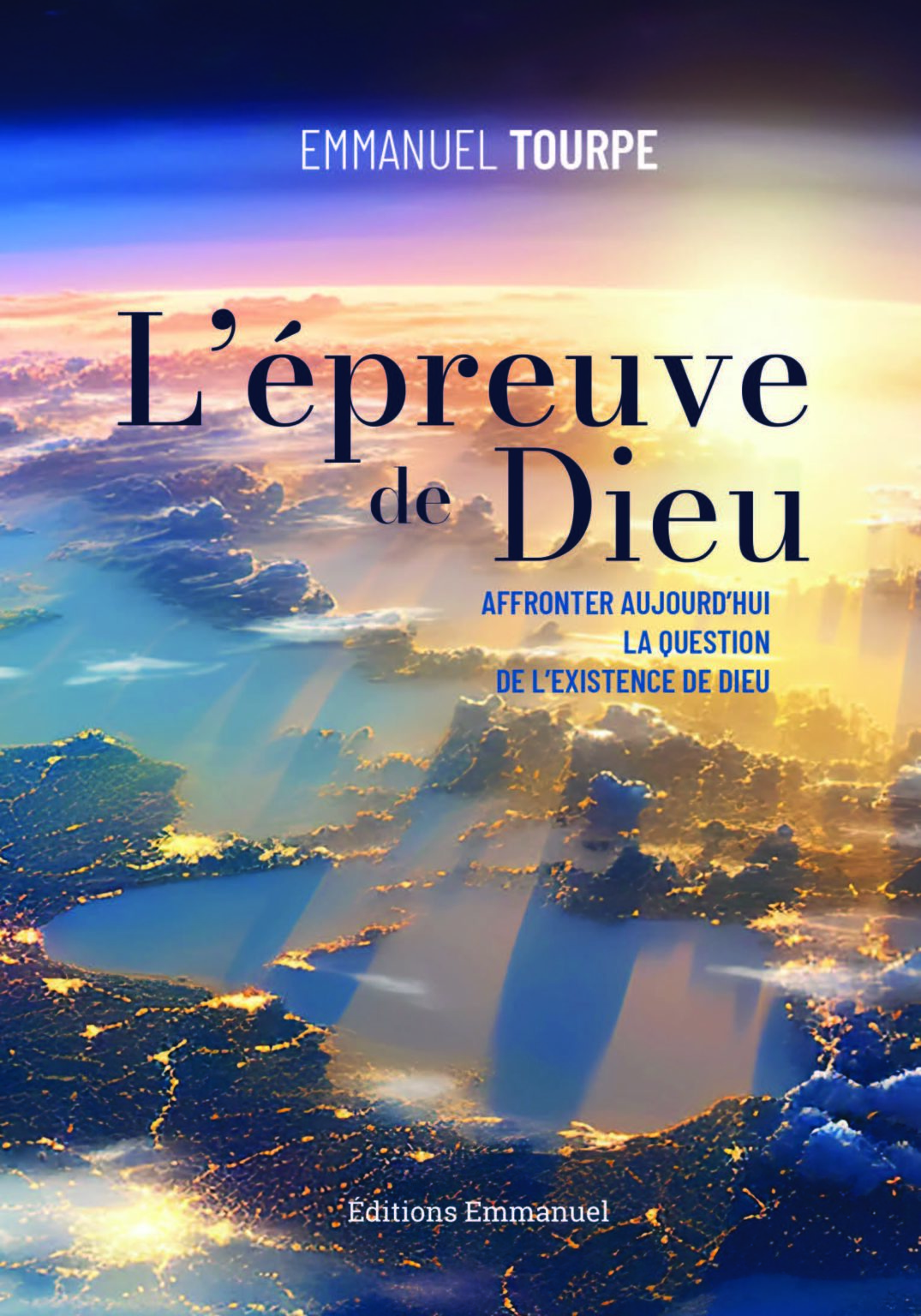
Cet ouvrage stimulera un parcours devant la question de Dieu en puisant à la clarté que peut apporter des outils philosophiques. Il s’agit d’abord de tirer de différentes figures de l’athéisme des représentations de Dieu auxquelles il vaut mieux ne pas croire. Face à la question du mal, un détour s’impose pour évoquer la manière dont l’homme, fini, limité, participe à l’infini de Dieu. Il convient aussi de laisser résonner dans nos intelligences des expériences de Dieu qu’on ne peut réduire au niveau de la psychologie parce qu’elle relève, comme le témoignage d’Etty Hillesum le dévoile, de la capacité à se mettre à l’écoute du plus intime de soi-même. Sans se leurrer sur une idée de Dieu que nous aurions d’emblée en nous. Rimbaud disait : « moi est un autre », ainsi que dans un dialogue intérieur, la présence intime de Dieu se laisse découvrir dans l’inachèvement de la conscience de soi. La question ne peut trouver une réponse seulement philosophique. La raison peut mettre des mots sur le cheminement mystique qui saisit au plus intime le sens de l’existence, jusqu’à un désir infini qui nous mobilise et nous traverse.
Pourquoi la démocratie a besoin de la religion
Hartmund ROSA, Pourquoi la démocratie a besoin de la religion. À propos d’une relation de résonance singulière, préface de Charles Taylor, texte prononcé à la conférence diocésaine de Würzburg en 2022, La Découverte, Paris, 2024, 80 p
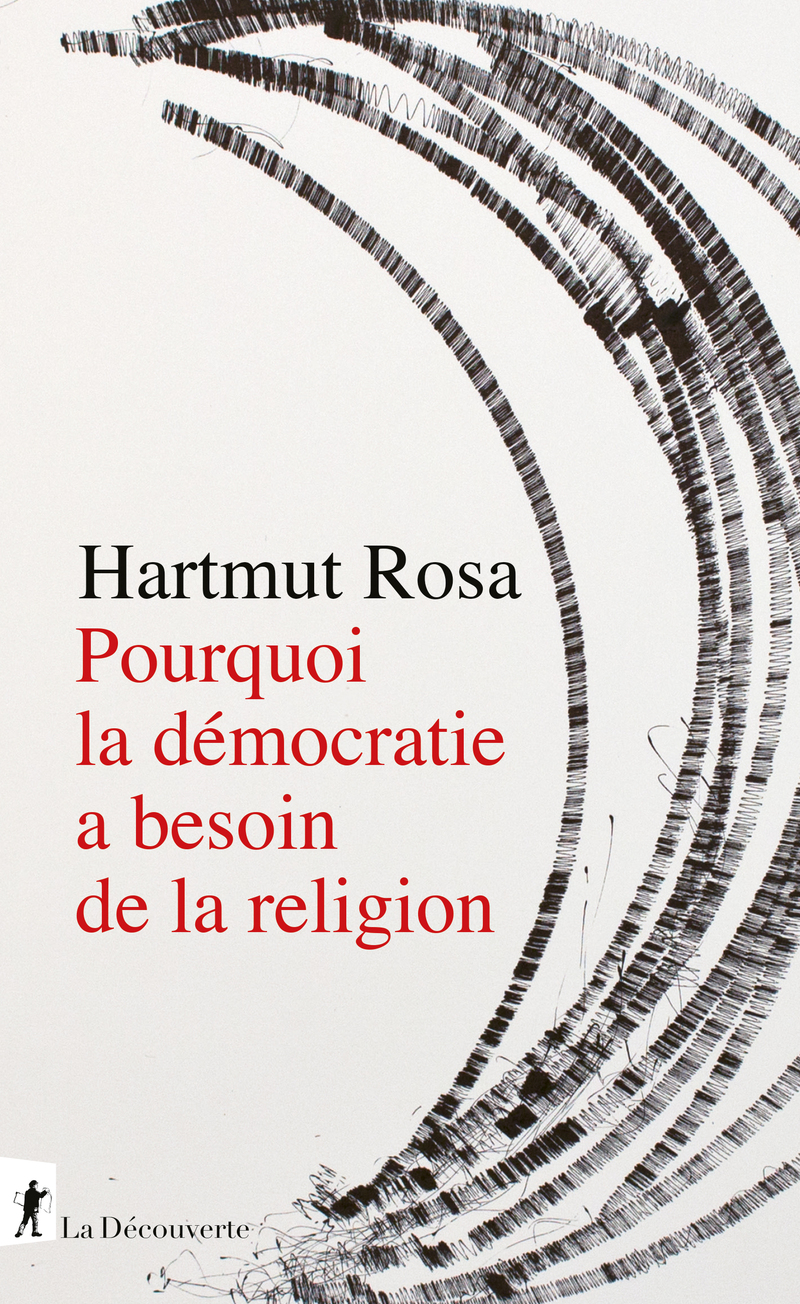
Rosa, sociologue, souligne les difficultés actuelles à établir de véritables relations dans un monde qui s'accélère. Le concept de résonance, qui nécessite attention et disponibilité, devient difficile à atteindre. Le progrès, autrefois moteur, est incertain, et un changement de posture est nécessaire pour envisager un avenir meilleur. Rosa explore comment la religion, en décalage avec la logique de croissance, favorise cette résonance, vécue comme communion. Il montre ainsi que la foi, loin d'être dépassée, peut renouveler la démocratie.
Foi de jeunes
Inès VIGNON et Suzanne NOURRY (coordination), Foi de jeunes, préface de sr Nathalie Becquart, postface de sr Anne-Flore Magnan, Editions Jésuites, Bruxelles, 2024, 105 p

24 jeunes livrent leur témoignage d’une expérience de Dieu chaque fois unique. Cet aspect toujours particulier de la rencontre de Dieu se montre à travers la diversité des images utilisées pour en parler. Ainsi la foi est comparée tantôt à une plante, à une paire de baskets, à une éolienne, à un diapason, … Ce qu’il y a de proprement indicible dans l’expérience de la présence de Dieu, on le rejoint par les images, un peu comme les paraboles de Jésus ; des images diversifiées sont comme autant de chemins spirituels qui peuvent enrichir le lecteur qui n’aurait pu que bien pauvrement se les imaginer. La lecture de ce livre peut se faire comme une conversation dans l’Esprit, une manière de marcher avec ces jeunes pour retracer, avec eux, des esquisses de ce que sera l’Église de demain.

